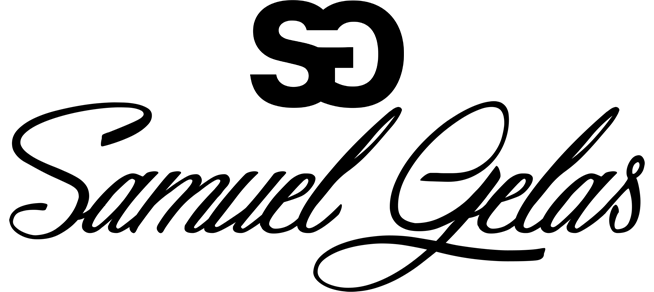NOUTOUPATOU
du 17 septembre au 20 novembre
Noutoupatou, Mondes caribéens en mouvement
Vernissage : 18 novembre, 18h
Galerie A plus A, Venise, San Marco 3073
Flavio Delice, Samuel Gelas, Shamika Germain
Organisé par la Galerie A plus A en collaboration avec le Campus Caraïbéen des Arts soutenu par l’Institut français et la Direction des affaires culturelles de la Martinique.
commissaire d’exposition : Paola Lavra
La galerie A plus A et le Campus Caraïbéen des Arts sont heureux d’annoncer « Noutoupatou, Mondes caribéens en mouvement ». Cette exposition, soutenue par l’Institut français et la Direction des affaires culturelles de la Martinique, coïncide avec la clôture de la 60e Exposition internationale d’art, la Biennale de Venise.
Noutoupatou, un mot, un son, une invitation à contempler les œuvres de trois jeunes artistes issus de la scène artistique caribéenne, originaires d’Haïti, de Guadeloupe et de Saint-Martin, diplômés du Campus Caraïbéen des Arts de Fort-de-France en Martinique : Flavio Delice, Samuel Gelas et Shamika Germain. Le commissariat de l’exposition est assuré par Paola Lavra, anthropologue et enseignante au Campus Caraïbéen des Arts et ancienne élève de l’École d’études curatoriales de Venise, en collaboration avec May Clementé, directrice de la Galerie École du CCA.
Le projet prévoit une résidence d’artistes à Venise, une masterclass animée par Julien Creuzet et une série d’initiatives visant à créer un espace d’échange et de rencontre entre les trois artistes et la ville de Venise, deux îles appartenant à un vaste archipel porteur d’un réseau complexe de relations et de connexions avec le monde. La résidence culminera avec le vernissage de l’exposition, offrant au visiteur l’opportunité de se confronter à l’empreinte historique, sociologique et culturelle qui a profondément marqué l’espace et le corps, à l’identité plurielle et contradictoire d’une société coloniale qui questionne sans cesse ses origines, son appartenance et son statut territorial d’île française au sein de la sphère plus vaste et complexe de l’archipel caribéen, et son devenir dans l’espace globalisé des Amériques.
Aujourd’hui, la déconstruction progressive du paradigme de la modernité occidentale ouvre la voie à de nouveaux paradigmes de pensée et d’action singuliers, portés et traduits par le langage spécifique de l’art contemporain, inspiré par la poétique glissantienne de la relation et par « Tout monde ».
C’est dans ce contexte que Flavio Delice suit le parcours et la cartographie tracés par les habitants d’Haïti en migration constante vers d’autres rivages. Terre d’origine qu’il n’a jamais habitée, « non indigène », Haïti est à l’origine de tout un imaginaire poétique et artistique, tissé des témoignages et des récits des Haïtiens en exil.
Une véritable « ethnographie des passages » prend forme dans les toiles et les sculptures réalisées à partir de matériaux recyclés qui composent le quotidien, marqué par la débrouillardise et l’urgence de la vie d’une population haïtienne exposée aux bouleversements telluriques et au déséquilibre permanent d’un pays en guerre, qui paie encore aujourd’hui le prix de sa révolution. Carnet de voyage vers la terre des rêves et de l’enfance, cet ensemble d’œuvres s’inscrit dans le contexte dramatique des conflits qui agitent actuellement l’île d’Haïti.
Shamika Germain utilise le même procédé d’immersion et de capture (images, mots et sons) pour narrer une autre migration : la sienne, celle des « Enfants de la Ddass », ces enfants confiés aux institutions publiques ou élevés en familles d’accueil et en foyers. La collecte des voix et des silences de ces corps et de ces âmes séparés du ventre maternel se traduit par une production riche, allant de la photographie au dessin et à la peinture, de la sculpture au dispositif filmique, de l’installation à la performance de textes manuscrits. Des matériaux durs comme le fer et le ciment de fer s’opposent à la douceur de la laine dans la fabrication de « berceaux » qui évoquent le vide et le manque d’une enfance sans rêves.
L’intimité devient ainsi le support d’une écriture plastique et graphique singulière et polymorphe, dans la création d’une esthétique du traumatisme, traduite par le terme « créolo bless », une forme de catharsis tragique opérée par la reproduction et la matérialisation de la blessure originelle. L’histoire individuelle des « Élèves de l’État » narrée par Shamika fait écho à celle des Bumidom et des Enfants de la Creuse (1962-1984), vaste opération de migration de masse menée par l’Office du développement des migrations dans les départements d’outre-mer, dont les enfants des territoires des DOM (La Réunion, Martinique, Guadeloupe) furent à la fois l’objet et les victimes collatérales.
Enfin, l’univers de l’enfance est présent et actif dans les imposantes toiles de Samuel Gelas, vastes portraits de groupe qui renvoient à l’expérience de chaque être humain constituant un groupe social, mais aussi à celle d’une humanité dont l’enfance est le dénominateur commun. Le dispositif de la photo de classe est distordu par le langage codé d’un bestiaire qui semble illustrer les dérives d’une société caractérisée par une identité hybride, par la rencontre/le choc entre multiculturalisme et mondialisation. Les enfants sont la société de demain dans la salle de classe qui rassemble et encourage la rencontre des origines, des religions et des différents systèmes de pensée.
Dans un contexte de crises et de migrations multiformes engendrant des inégalités liées aux notions de classe, de race et de genre, la poétique de la relation, somme théorique d’Édouard Glissant, subvertit le concept de classe et inspire un projet artistique fondé sur la force du collectif. Le portrait de classe inscrit l’individu dans un groupe social qui affirme avec force sa singularité tout en revendiquant son appartenance au monde, à l’être « Tout monde », où « la relation devient la somme infinie de toutes les différences » (cf. L’invitation au voyage, 22 novembre 2004, E. Glissant interrogé par Laure Adler).
L’invité d’honneur est l’artiste Julien Creuzet, représentant la France à la 60e Biennale de Venise, qui animera une masterclass retraçant les différentes étapes de son parcours, débuté en Martinique.
La masterclass est organisée par l’Institut français, en collaboration avec le Campus Caraïbéen des Arts. Elle s’adresse aux élèves des Académies des Beaux-Arts de Martinique et de Caen, ainsi qu’aux élèves du Lycée d’arts appliqués Victor Anicet de Saint-Pierre. Cet événement a été rendu possible grâce au soutien de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Fondé sur l’égide d’Aimé Césaire en 1984, l’actuel Campus Caraïbéen des Arts est une École Supérieure d’Arts, sous tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication, et intégrée au système des écoles supérieures d’art françaises. Seul centre francophone d’enseignement des arts visuels dans les Caraïbes et en Amérique centrale, l’institut s’inscrit dans le cadre du système européen dont il est doté afin de refléter la territorialité plus large que lui confèrent l’histoire et le statut de « territoire français d’outre-mer ».